Que fit la police ? entretien avec maurice rajsfus
Catégorie :
Thèmes :
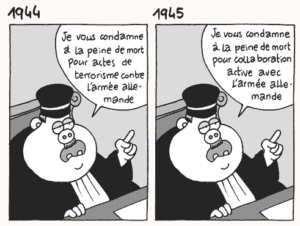
Dans une tribune intitulée « Pour la police aussi, il faut un devoir de mémoire », tu proposes de détourner la proposition de Sarkozy de faire parrainer des enfants juifs victimes du génocide et que ce soit les forces de l’ordre et non les élèves de CM2 qui se chargent de cette mémoire.
Oui, parce que c’est la police française qui a livré les enfants juifs aux nazis. Ainsi chaque policier se verrait chargé nommément d’un des 11400 enfants disparus.
Tu n’as pas peur que ce soit traumatisant pour les policiers ?
Si, si, je suis très inquiet pour eux [sourire]… Le problème aujourd’hui c’est qu’ils n’ont pas d’état d’âme. Tu as vu, ils ont encore débarqué dans une école récemment pour embarquer un gamin de neuf ans qui s’était chamaillé avec un autre élève.
C’est l’apprentissage du civisme, non ?
À ce propos, l’obligation de civisme à l’école me rappelle une anecdote. Pendant la guerre, à Vincennes, mon voisin s’appelait Henri Rostocker, il avait 10 ans et a été raflé le même jour que moi, le 16 juillet 1942. Il a été déporté. Quand je travaillais sur mon livre Jeudi noir consacré à la rafle du Vel’ d’Hiv’, je n’ai rien trouvé sur lui aux archives de la ville. Par curiosité, j’ai alors regardé au bulletin municipal officiel et je me suis aperçu qu’il faisait partie des écoliers lauréats qui avaient écrit la plus belle lettre au maréchal Pétain au mois de juillet. Quand le bulletin a été publié, Henri était parti en fumée depuis un mois. Depuis, j’ai des réflexions amères sur le rappel au civisme. C’est vrai qu’à l’époque on ne chantait pas La Marseillaise mais Maréchal, nous voilà.
As-tu regardé le documentaire diffusé sur France 2, qui cherche à revaloriser le sauvetage des Juifs par la Résistance ?
Non, j’ai pas voulu le voir. Dire que la Résistance a voulu sauver les Juifs, c’est mensonger. Primo, ou la Résistance n’était pas assez importante pour pouvoir intervenir, ou ce n’était pas l’objectif. La Résistance-Rail a pu attaquer des trains de permissionnaires allemands ou de munitions, mais n’a jamais cherché à stopper un train de déportation. De même, jamais l’aviation alliée n’a bombardé les réseaux de chemins de fer qui menaient aux camps. Cela n’a jamais constitué un objectif, ni un mot d’ordre.
Parlons un peu de ton histoire personnelle. Le 16 juillet 1942, tu es raflé avec tes parents mais tu échappes à la déportation…
La circulaire d’application de la rafle du Vel’ d’Hiv, du 13 juillet 1942, précise que la police doit arrêter des Juifs étrangers de 16 à 45 ans. Or ils vont arrêter 4 150 enfants, pratiquement tous français, et ils vont rafler tous les étrangers, du berceau au brancard. Des mômes malades, des femmes en couche, des vieillards grabataires… Bref, ils font du chiffre. Je ne sais pas s’ils ont été payés à la prime comme Sarkozy l’a institué maintenant, mais à la limite s’ils l’ont fait gratuitement c’est encore plus dégueulasse. Moi j’ai été arrêté avec mes parents et ma sœur, et emmené au commissariat de Vincennes. Là, par hasard, un commissaire décide que les enfants de quatorze à seize ans doivent sortir.
Après, je sais pas trop comment on s’en est sortis, ma sœur et moi. On est rentrés dans notre logement qui était en train d’être pillé par la concierge et on y est restés jusqu’à la fin de la guerre. On nous a oubliés pendant deux ans, malgré notre étoile juive. Comme quoi la répression n’était pas cohérente. Ma sœur était au lycée et moi j’étais apprenti joaillier, on a survécu, parce qu’au moment de la séparation, ma mère avait confié tout ce qu’elle avait à ma sœur. Puis le 15 juin 1944, on a été informés qu’on risquait une rafle dans les jours qui suivaient, je me suis planqué dans le Vexin grâce à des amis du centre d’apprentissage, ma sœur chez une copine. Ce qui est terrifiant, c’est qu’en consultant les archives quarante ans plus tard, je suis tombé sur les documents qui prévoyaient cette rafle en banlieue parisienne.
À la Libération, je n’avais qu’une idée en tête, c’est de faire la révolution. Il m’a fallu des années pour comprendre que pour faire la révolution il faut bosser avec les autres [rires]. J’ai adhéré aux Jeunesses communistes, qui m’ont exclu manu militari deux ans plus tard, en octobre 1946, comme « provocateur policier » et « hitléro- trotskiste ». C’était le jargon du PCF de l’époque. Ma sœur a quitté le PC avant moi, il faut dire qu’à la première réunion de la cellule du parti, je suis tombé sur le flic, Mullot, qui nous avait arrêté. À l’époque, des centaines de flics ont adhéré au PC ou à la CGT pour être du côté du manche. Je tombe sur lui et le soir je raconte ça à ma sœur. On écrit alors au Comité central et on reçoit une lettre de Jacques Duclos qui assure que le camarade Mullot a rendu de remarquables services au Parti durant la guerre, par conséquent qu’on ne peut pas lui imputer etc. etc.
Après, je me suis trouvé dans un milieu fantastique qui était le mouvement des Auberges de jeunesse, où venaient pêcher les anars et les trotskistes. J’ai été vers les seconds pendant deux ans mais pas vraiment dans la ligne. Fin 48, je quitte le PCI avec Castoriadis, le fondateur de Socialisme ou Barbarie (SoB) qui a été une rencontre très bénéfique pour moi. C’est le premier dans les milieux marxistes à critiquer la défense inconditionnelle de l’URSS. Je ne suis pas resté très longtemps à SoB. C’étaient de grands théoriciens, ça me passait un peu au-dessus de la tête. Je suis revenu au militantisme au moment de la guerre d’Algérie. En 1955, j’ai participé à la création du Comité contre le départ du contingent en Algérie. Ça nous a valu quelques coups de bâton sur la tête. Puis arrive mai 68, je fais partie des naïfs qui pensent que rien ne sera plus jamais comme avant. En 1950, on peut dire que j’ai 40 ans et en 68, je rajeunis de 20 ans. Après mai 68, je suis devenu membre d’un groupuscule à un seul adhérent, moi-même… [rires]
Le 6 avril 1993, à la suite de l’assassinat du jeune Makomé dans le commissariat du XVIIIe arrondissement, on fonde Que fait la police ? avec Jean-Michel Mension alias Alexis Violet, mon camarade au sein de l’Observatoire des libertés publiques jusqu’à sa mort en 2006.
Tes travaux sur la police durant la période de Vichy ont ouvert un champ d’étude historique totalement inédit. Comment t’es-tu lancé dans ces recherches ?
J’étais en fin de carrière de journaliste, je me suis débrouillé pour travailler à mi-temps, ce qui m’a laissé du temps pour faire ces recherches. À la fin des années 70, j’ai commencé à travailler sur la police sous l’Occupation. Ce n’est pas un compte personnel que je règle : il se trouve juste que ni la magistrature, ni la police n’ont eu de comptes à rendre sur leurs agissements durant la collaboration. Il n’y a eu aucun procès. En 1940, les juges ont tous prêté serment au maréchal Pétain sauf un seul, le juge Didier, ce qui lui a juste valu un peu de placard, jusqu’à la Libération. Après la guerre, ses confrères lui en voulaient tellement de s’être désolidarisé que sa carrière a été brisée, il n’a jamais eu d’avancement. Dans la police, c’était pareil, puisqu’un type comme Papon a pu devenir préfet de police. Il y a bien sûr eu des exemples de policiers qui ont prévenu des Juifs à propos des rafles. Par exemple, des amis de mes parents, chiffonniers à Gennevilliers, ont été avertis par l’inspecteur qui leur soutirait un bakchich. Mais c’est loin d’être le cas général. Même ceux qui ont prévenu des Juifs ont dû participer aux rafles. Il fallait être collabo le jour pour être résistant la nuit. Au lendemain de la rafle du Vel’ d’Hiv’, un seul policier a démissionné, au commissariat de Nogent.
Au moment de la Libération, connaît-on des actes de vengeance vis-à-vis de la police ?
Je formule une hypothèse : Je pense que sur les cent cinquante-deux policiers morts « en braves » durant la Libération de Paris, un certain nombre ont dû prendre une balle dans le dos. Personne ne pouvait oublier leur comportement pendant quatre ans. D’ailleurs, au musée de la Police de Paris, on voit un tableau statistique des policiers morts « en braves » pour la Libération et un autre panneau de ceux « morts pour le devoir », c’est-à-dire tués par des malfrats. Or, tu t’aperçois que dans le deuxième panneau la moyenne de deux à trois par mois en temps normal monte à plus d’une dizaine en 1942, 1943, 1944 [1 en 1940 ; 2 en 1941 ; 8 en 1942 ; 13 en 1943 ; 12 en 1944] puis ça redescend après la guerre. Il ne s’agit donc pas d’actes de malfrats. De même, ça remonte durant la période de 1955 et 1962, c’est-à-dire pendant la guerre d’Algérie.
Tes travaux t’ont-ils valu des inimitiés particulières ?
Beaucoup ! D’abord de la part de ma tribu d’origine, parce que j’avais commencé par publier un bouquin qui s’appelait Des Juifs dans la collaboration, sur l’Union Générale des Israélites de France, qui assurait la représentation des juifs auprès du gouvernement de Vichy. Ce n’était pas pour pointer du doigt des gens comme collabos mais parler de ces notables français, qui ne se considéraient pas comme Juifs mais comme « Israélites », et qui n’ont pas été gênés de prendre la tutelle des Juifs métèques dont ils voulaient se débarrasser. Ce fut une collaboration de classe, d’une certaine manière, également xénophobe. Ils n’avaient pas compris qu’on ne négocie pas avec les nazis et que leur tour viendrait au tourniquet… Puis j’ai eu des problèmes terribles à propos de ce que j’ai écrit sur le problème palestinien. J’ai été montré du doigt comme un homme de main d’Arafat, voire un complice de Faurisson.
D’autre part, les historiens institutionnels m’en ont toujours voulu d’avoir mis les pieds dans leur pré carré. Ils ne m’ont jamais aidé ni cité. Il faut dire aussi que, sur la centaine de bouquins écrits sur la Résistance, pas un seul n’était consacré à la police, pas un seul chapitre non plus. J’ai été blacklisté de certaines bibliothèques universitaires.
Que t’évoque le climat actuel de surenchère répressive : fichage des étrangers et prélèvement ADN, prime à la délation anonyme, rafle de sans-papiers dans un foyer de travailleurs maliens, opacité des centres de rétention…
Ça rappelle forcément des mauvais souvenirs, sauf que je suis obligé de préciser, pour ne pas être considéré comme un type excessif, qu’il ne faut pas faire d’amalgame. Ce n’est plus l’époque nazie, Auschwitz n’est pas au bout, heureusement ! Mais que de telles choses puissent se dérouler dans un régime démocratique est une circonstance aggravante. Il ne faut pas oublier que le fichage des étrangers et la création d’une police des étrangers ont commencé sous Daladier, en mai 1938. Ce qui a été aggravé en novembre 1938 avec la déclaration du ministre de l’Intérieur Albert Sarraut, un bon républicain radical-socialiste, qui prévoyait de débarrasser la France de la « tourbe étrangère » et de créer des camps de concentration. C’est ce que Michel Marrus et Robert O. Paxton ont appelé « Vichy avant Vichy » (Vichy et les Juifs, 1981). En février 1939, les républicains espagnols vont être parqués dans des camps à leur arrivée dans les Pyrénées. Puis les ressortissants allemands, la plupart opposants ou juifs, seront arrêtés et enfermés en décembre 1939. En mai 40, des femmes allemandes dites apatrides seront aussi internées au camp de Gurs. Parmi elles, Hannah Arendt. Ce qui est peu connu.
Aujourd’hui, peut-on imaginer un monde sans police ?
Je crois que la question est mal posée. Il y a quelques années, on m’avait invité pour parler du pouvoir de la police dans une loge du Grand Orient de France, lors d’une « tenue blanche », séance où ils invitent quelqu’un d’extérieur. Je n’avais pas terminé mon exposé que je provoquais déjà des hurlements indignés dans la salle : « Est-ce que vous croyez que l’on peut se passer de police ? » J’ai répondu que ça, c’était l’utopie ultime. Je crois pour ma part qu’il faut commencer par des utopies moyennes, il faut d’abord leur rogner les ongles. Il faudrait que policier ne soit plus un métier mais une fonction. Par exemple, au bout de quatre ou cinq ans, on changerait de poste dans la fonction publique, afin de ne pas prendre de mauvaises habitudes, que l’esprit de corps ne s’installe pas. Quand Pierre Joxe est redevenu ministre de l’Intérieur en 1988, il a proposé de désarmer la police. Il a dû faire volte-face tellement ça a hurlé. Aujourd’hui on n’arrête pas de l’enfler, de la surarmer… Leur comportement est devenu invraisemblable. Ce sont des fonctionnaires qui ont un maximum de pouvoir et qui s’arrogent même ceux qu’ils n’ont pas. Ils traitent le « citoyen », pour employer un mot à la mode, comme de la merde. Si tu leur réponds, il y a outrage. Si tu résistes, il y a rébellion. Si tu prends la foule à témoin, il y a incitation à l’émeute.
Une fois, j’avais animé un débat en banlieue, aux Lilas. Il y avait là un certain Mohamed Douhane, porte-parole du syndicat Synergie officiers, et je m’étonnais – c’est mon côté romantique – qu’un fils d’immigré algérien serve un État qui a opprimé ses parents. Réponse indignée : « Je ne suis pas le beur de service, je suis un policier républicain. » Je lui ai dit que dans mon enfance, dans ma famille de Juifs polonais qui avait connu les pogroms, il était impensable qu’un des nôtres puisse devenir flic.
Tes projets ?
J’ai un bouquin à paraître fin mars, Les Mercenaires de la république, aux Éditions du Monde libertaire, qui parle du comportement actuel de la police vis-à-vis des sans-papiers et des précaires. Je vais aussi sortir un pamphlet en mai qui s’intitule Portrait physique et mental du policier ordinaire, où je les décris de la tête aux pieds. On réédite mon bouquin sur mai 68, Sous les pavés la répression. Le 26 juin, j’irai témoigner au procès en cassation du groupe La Rumeur, pour les propos d’Hamé sur « les centaines de jeunes abattus par la police. » Pour finir, si j’avais un vœu à formuler après ma mort, c’est que mes cendres soient répandues le long des murs de la préfecture de police à Paris, le lieu du crime de la rafle du 16 mai 1942 et aussi du 17 octobre 1961.
https://cqfd-journal.org/Que-fit-la-police

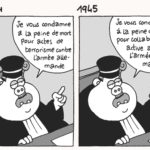
Maurice n’est plus.
Il nous a quittés le samedi 13 juin 2020, à 92 ans,
après un dernier combat inégal contre la maladie.
Maurice Plocki, dit Maurice Rajsfus, dit Michel Marc, dit A. Joffé était né le 9 avril 1928, à Paris,
de parents émigrés juifs polonais, ayant fui autant l’antisémitisme que le carcan étouffant de la religion.
Arrêté au matin du 16 juillet 1942, avec sa sœur et ses parents, durant la rafle du Vel d’Hiv,
Il ne doit sa survie (ainsi que sa soeur Jenny) qu’à l’incohérence administrative et à la lucidité de ses parents qui ne les retinrent pas avec eux, à la différence d’autres parents, lorsqu’une possibilité de libération des enfants de moins de 16 ans fut annoncée.
L’un des deux flics venus arrêter la famille était un voisin de palier qui ne faisait que son « devoir » de flic, aux ordres de l’occupant nazi.
Ce rapport plus que rugueux avec la police française, dès l’âge de 14 ans, ne devait pas faciliter, par la suite, son rapport avec cette institution qui, contre toute évidence, se proclame républicaine.
Nous avons pu, lors de ses derniers jours de lucidité lui dire ce qui se passait à Paris et dans le monde entier, contre les violences policières et le racisme policier.
Il est paradoxal qu’il soit parti alors que le combat qu’il a mené souvent seul, en éclaireur, sur ces questions, durant des dizaines d’années, prend aujourd’hui des dimensions à la hauteur de ces violences systémiques inacceptables et de leur déni par leurs auteurs et leurs donneurs d’ordre.
Le bulletin Que fait la police ?, publié trimestriellement entre 1994 et 2014, en témoigne. Les archives en sont toujours accessibles sur le Net (http://quefaitlapolice.samizdat.net)
Une fiche lui est consacrée dans Le Maitron en ligne (dictionnaire biographique du mouvement ouvrier) pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus sur son long parcours militant. (https://maitron.fr/spip.php?article205974)
Maurice nous a appris l’esprit critique et l’insoumission à l’air du temps. Il n’a jamais recherché le confort des majorités, dont il se méfiait. Passé par plusieurs partis politiques, il a fini par choisir une voie personnelle, tout en continuant de « cousiner », comme il aimait à le dire, avec les uns et les autres, à gauche de la gauche.
Michelle et Marc
https://www.ujfp.org/spip.php?article7919
C’est avec tristesse que nous apprenons la mort du camarade Maurice Rajfus.
Infatiguable militant anticolonialiste, historien méticuleux de la répression sous toutes ses formes. Son humour et sa modestie font de lui une des figures qui ne s’oublient pas !
Ses chroniques acides (acab aussi) et anti-autoritaires peuvent encore être lues sur : http://quefaitlapolice.samizdat.net/
Salam ya Maurice !