Détruisons le travail (alfredo m. bonanno)
Catégorie :
Thèmes :
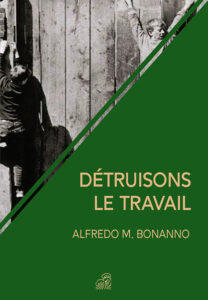
« Parler de destruction du travail semble simple. Mais il n’y a rien de plus difficile que de parler de destruction. Parce qu’en nous tous, au fond de notre conscience, il y a la peur de l’avenir. Parlons clairement : révolutionnaires ou pas, il y a toujours la peur de l’avenir. Car la peur de l’avenir, c’est la peur de la mort, car la mort viendra évidemment à notre rencontre depuis l’avenir. Ils sont frère et sœur. »
Nous ne sommes pas intéressés par les préoccupations politiques de ceux qui considèrent le chômage comme un danger pour l’ordre et la démocratie. Nous ne sommes pas non plus concernés par la nostalgie du manque de professionnalisme. Nous sommes encore moins enthousiasmés par les réformateurs du travail à la chaîne ou du travail intellectuel régi par la planification industrielle avancée. De même, nous ne sommes pas concernés par l’abolition du travail ou sa réduction à un minimum tolérable dans une vie ainsi imaginée pleine et heureuse. Derrière tout cela il y a toujours les griffes de ceux qui veulent organiser notre existence, penser pour nous ou nous suggérer poliment de penser comme eux.
Nous sommes pour la destruction du travail. Procédons dans l’ordre : notre position est totalement différente et c’est ce que nous tenterons d’expliquer.
Sommaire:
Avant-propos
Détruisons le travail
La destruction du travail (transcription de deux conférences à Athènes en 2009)
S’il vous plaît, restons les pieds sur terre
Post-face
90 pages // 3 euros (- 30% pour la distribution)
Commander par mail : tumult_anarchie[[a]]riseup.net
Voici l’avant-propos:
Le travail. C’est un sujet qui revient incessamment, et avec autant plus de vigueur en cette période de « crise sanitaire » suite à la propagation mondiale d’un virus, qui inaugure une nouvelle restructuration de l’économie. Pendant que les actions chutent, que le pétrole se commerce maintenant à prix négatif (le producteur paie l’acquéreur) et que les États et institutions financières injectent des sommes faramineuses pour adoucir le ralentissement de l’économie, le travail fait lui aussi objet de débat. Quel travail est nécessaire pour maintenir la consommation à flot ? Quel travail est nécessaire pour garantir des taux de profits acceptables aux entreprises et générer suffisamment de rentrées pour les États ? Est-t-il, à l’ère du technomonde, nécessaire de se rendre au travail, ou suffit-il de disposer d’une connexion à la maison ? Le chômage va-t-il exploser ?
Honnêtement, ces problèmes ne m’intéressent que jusqu’à un certain point. Je n’ai jamais cautionné les courants qui ont diamétralement opposé le monde du travail et le monde du capital, ces deux mondes ont trop d’intérêts communs, trop de mentalités partagées, trop de rapports similaires pour être considérés vraiment séparés. Plus encore aujourd’hui, maintenant qu’en Occident, la liquidation de la « classe ouvrière » a été accomplie. Non pas que les ouvriers ont disparu, mais la mentalité de classe (génératrice de la « conscience de classe » comme on disait autrefois) oui. Elle a été remplacée par autre chose, quelque chose de plus hybride, flexible, tolérant, inconscient des chaînes toujours plus colorées et invisibles qui retiennent l’exploité à sa place. Si l’introduction des technologies de télécommunication et l’automatisation de la majorité des processus productifs y sont pour beaucoup, le capitalisme a toujours démontré cette capacité extraordinaire du vampire : il se nourrit du sang de la résistance pour grandir. Tout ce qui ne le tue pas, le renforce et lui inspire l’ouverture de nouveaux marchés, de nouveaux modes de production, de création de nouvelles identités.
Les atrocités, les guerres, l’esclavage, l’abrutissement, la pollution… toutes ces horreurs marquent la domination. Mais elles ne seraient possibles sans la participation active de tous. Oui, de nous tous et toutes, sans exception aucune. On a beau dire (et à raison) que le gérant d’une entreprise a plus de responsabilité que l’ouvrier qui se vend pour une paie, reste que sans le concours de l’ouvrier, la production ne se fait pas (c’est un problème éternel du capitalisme, et maintes dynamiques de développement poussent vers « l’absurdité » d’une production… libérée des producteurs). En cela, nous sommes rendus complices.
Tant que la réflexion et l’aspiration se cantonnent à l’intérieur du schéma productif capitaliste, nous ne ferons que bouger les marges, sans toucher à la substance. Une chaîne plus longue ou plus courte, voilà tout. Mais c’est vital, me diront les réalistes de la lutte, chaque pas en avant permet à l’ouvrier de vivre mieux, d’avoir plus de temps pour développer sa conscience, d’entamer une nouvelle « phase de lutte » plus incisive, plus radicale. Foutaises ! C’est justement par cette mentalité que le capital nous rend complices de son extension, son perfectionnement, sa marche funèbre en train de détruire la planète.
Non, c’est autre chose qu’il faut, quelque chose de complètement différent : la destruction du travail. C’est un vaste projet, aux proportions titanesques. Et la première chose à faire, c’est rompre avec le mythe de la croissance quantitative de la conscience des travailleurs, qui s’érigent partout (avec les exceptions d’usage, bien sûr) comme les défenseurs le plus acharnés de ce qui empoisonne, ravage, produit. A t-on jamais vu une grève qui visait la fermeture d’une centrale nucléaire, d’une usine chimique, d’une usine d’armement, d’une exploitation agricole industrielle ? Non, ces cathédrales de l’exploitation n’ont pu être attaquées que par celles et ceux qui ne se trouvaient (plus) à son ombre. Peut-être parmi eux y avait-t-il un ouvrier qui y travaillait, peut-être pas, cela ne change rien au propos.
La destruction du travail, c’est donc avant tout la destruction de la mentalité du travail. De la complicité qu’on entretient avec l’exploitation, en jouant notre rôle. Et ce rôle, comme on le voit limpidement ces dernières années, n’est plus du tout aussi rigide qu’il a pu l’être autrefois. Ce rôle est flexible, avec de larges marges de manœuvre (permettant même, pendant un certain temps, de survivre avec les aumônes de l’Etat sans « travailler »), générant une mentalité encore pire : celle où nous devenons exploiteur et exploité en même temps, à géométries variables, dans tous nos rapports. Au cœur du projet de la destruction du travail se trouve donc une tension vers le totalement autre, une créativité sans bornes.
Détruire le travail, c’est détruire, par l’attaque et le sabotage, les conditions qui rendent incontournable son existence. Si l’attaque contre les outils de la production est toujours possible, le regard, comme on le voit ces dernières années, doit désormais s’élargir : si la production se télématise, si le travail se télématise, les conditions qui le rendent possible sont les réseaux, les antennes-relais, les fibres optiques, les flux énergétiques. De telles attaques sont porteuses d’une énorme qualité : celle du refus global d’un monde, et non pas une aspiration à son aménagement.
Mais « comment ? », dirait-t-on peut-être, on ne peut pas manger d’une fibre optique sectionnée ? Comment je fais alors ? Une demande tout à fait réaliste, à laquelle il n’y a, pour l’instant et en excluant toutes les pratiques d’auto-exploitation, qu’une seule réponse à mon avis : l’expropriation. Aller prendre l’argent et ce dont on estime avoir besoin là où cela se trouve. Ce n’est pas une question technique (même si on a certes besoin de certaines capacités pour dévaliser une villa ou vider les coffres d’une banque), mais plutôt, disons, morale. On a été éduqué depuis notre enfance à ne pas allonger la main, à ne pas prendre ce qui n’est pas nôtre. Outre les lois de l’État, ce sont des règles morales qui veillent implacablement sur nous. Pour prendre, pour voler, il faut transgresser ces règles, et cela demande un effort considérable où nous mettons notre vie en jeu. Certes, s’il ne s’agissait que d’opérer un transfert illégal de richesse, c’est-à-dire, si avec l’argent exproprié nous ne saurions faire rien d’autre que de faire la même chose que son ancien propriétaire (acheter une voiture de luxe, empiler des marchandises aussi inutiles que nocives), nous ne serions pas en train de détruire le travail, nous serions en train de reproduire sa mentalité, de façon illégale bien sûr, mais la substance reste la même. Ce n’est que quand nous utilisons ces moyens qu’on s’est appropriés par la force (et non pas par notre exploitation ou notre position sociale) de façon totalement autre que nous sommes en train de démolir le travail.
Détruire le travail n’équivaut pas au refus de toute activité. Activité humaine et travail ne sont pas des synonymes, et essayer de se soustraire au travail n’équivaut pas au rêve solipsiste de l’individu qui croit pouvoir se nicher dans un « en-dehors » désormais impossible. La destruction du travail est un projet individuel et collectif, car la création, l’expérimentation, l’élaboration de quelque chose de nouveau implique la subversion de tous les rapports. Elle est la qualité qui fait irruption dans la vie. En cela, autant au niveau individuel que collectif, cette destruction du travail est aussi la création, ici et maintenant, d’autres façons de vivre.
Enfin, la destruction du travail n’est pas la construction d’une identité rigide, attachée à un seul aspect (« le voleur »), elle inaugure l’explosion de toutes les activités possibles et imaginables. Voici quelques mots, écrit par l’anarchiste América Scarfó en 1930, qui me viennent à l’esprit en guise de conclusion de cet avant-propos : « Est-ce qu’il n’y a pas de beauté dans la variété ? La même beauté est dans la multiplicité des activités. A mon avis, l’individu qui a comme but et comme idéal la lutte vit une vie florissante. L’anarchiste qui exproprie ne le fait pas pour le sport, mais parce qu’il est poussé par une nécessité non purement économique ».
*
juin 2020

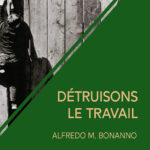
Comments
Les commentaires sont modérés a priori.Leave a Comment